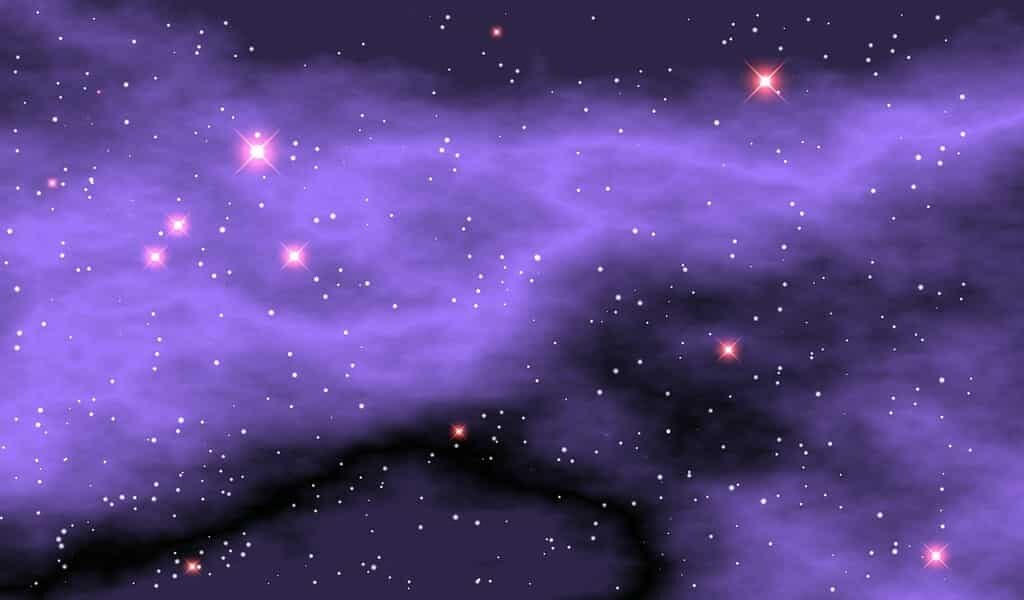
Des chercheurs de Toulouse ont repéré, grâce à un instrument de la NASA, quatorze sources célestes qui pourraient être des résidus de l'antimatière originelle. Si cette hypothèse était vérifiée, elle résoudrait un des grands mystères de l'Univers.
Avis aux astronomes en quête de grandes découvertes. Le 20 avril, trois de leurs confrères, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de l'université de Toulouse, ont dressé, dans Physical Review D, la liste de quatorze sources célestes dignes de la science-fiction. Il pourrait bien s'agir non pas d'étoiles mais d'antiétoiles, c'est-à-dire de leur exacte image-miroir. Au lieu d'hydrogène, elles sont faites d'antihydrogène (un « électron positif » tournant autour d'un « proton négatif »), d'antihélium, d'anticarbone, d'antioxygène...
L'échafaudage est très improbable car matière et antimatière ne font pas bon ménage : si elles se rencontrent, elles s'annihilent en émettant des photons gamma. Mais l'hypothèse, qui n'est pas nouvelle, résoudrait un mystère persistant dans notre Univers. Si, à son commencement, particules et antiparticules ont été produites en même quantité, car obéissant aux mêmes lois de la physique, pourquoi les secondes ont-elles disparu au profit des premières ? Nous sommes faits en effet de solide matière et vivons sans crainte d'annihilation soudaine par une pluie d'antimatière, qui semble avoir disparu. « Une réponse est que les antiétoiles seraient des résidus de l'antimatière originelle qui aurait persisté jusqu'à nous », esquisse Simon Dupourqué, doctorant et coauteur, avec Luigi Tibaldo et Peter von Ballmoos, de l'article dénombrant les possibles antiétoiles au-dessus de nos têtes.
Interaction fatale.
Leur calcul est en fait une estimation de la quantité maximum de ces drôles d'objets dans l'Univers, qui repose sur les données du principal télescope spatial à rayons gamma de la NASA, Fermi. Les chercheurs ont analysé les quelque 5 700 sources détectées en dix ans par l'instrument, puis ont exclu celles déjà connues et faites de matière, comme des pulsars ou des noyaux actifs de galaxies. Ils ont ensuite gardé celles qui émettent une bouffée de rayons gamma, correspondant à une interaction fatale entre matière et antimatière. Il n'en reste que quatorze, la plupart hors du disque de la Voie lactée. Enfin, un dernier calcul extrapole ce nombre à la totalité de l'Univers pour aboutir à environ « une antiétoile pour 400 000 étoiles », d'après Simon Dupourqué. « C'est vingt fois plus restrictif que la précédente estimation, en 2014, moins riche en données », conclut-il.
« L'analyse est intéressante et rigoureuse. Il y a évidemment des préjugés contre les antiétoiles mais il est naturel de tester expérimentalement cette hypothèse », estime Pierre Salati, professeur à l'université Savoie-Mont Blanc, spécialiste d'antimatière. Il rappelle d'ailleurs que la motivation vient aussi d'annonces de 2018, toujours pas confirmées, indiquant que le détecteur AMS-02, installé sur la Station spatiale internationale, aurait détecté huit noyaux d'antihélium : « Si c'était vrai, cela bouleverserait totalement nos modèles ! Et le moins déraisonnable pour expliquer ces antihéliums, ce sont les antiétoiles. »