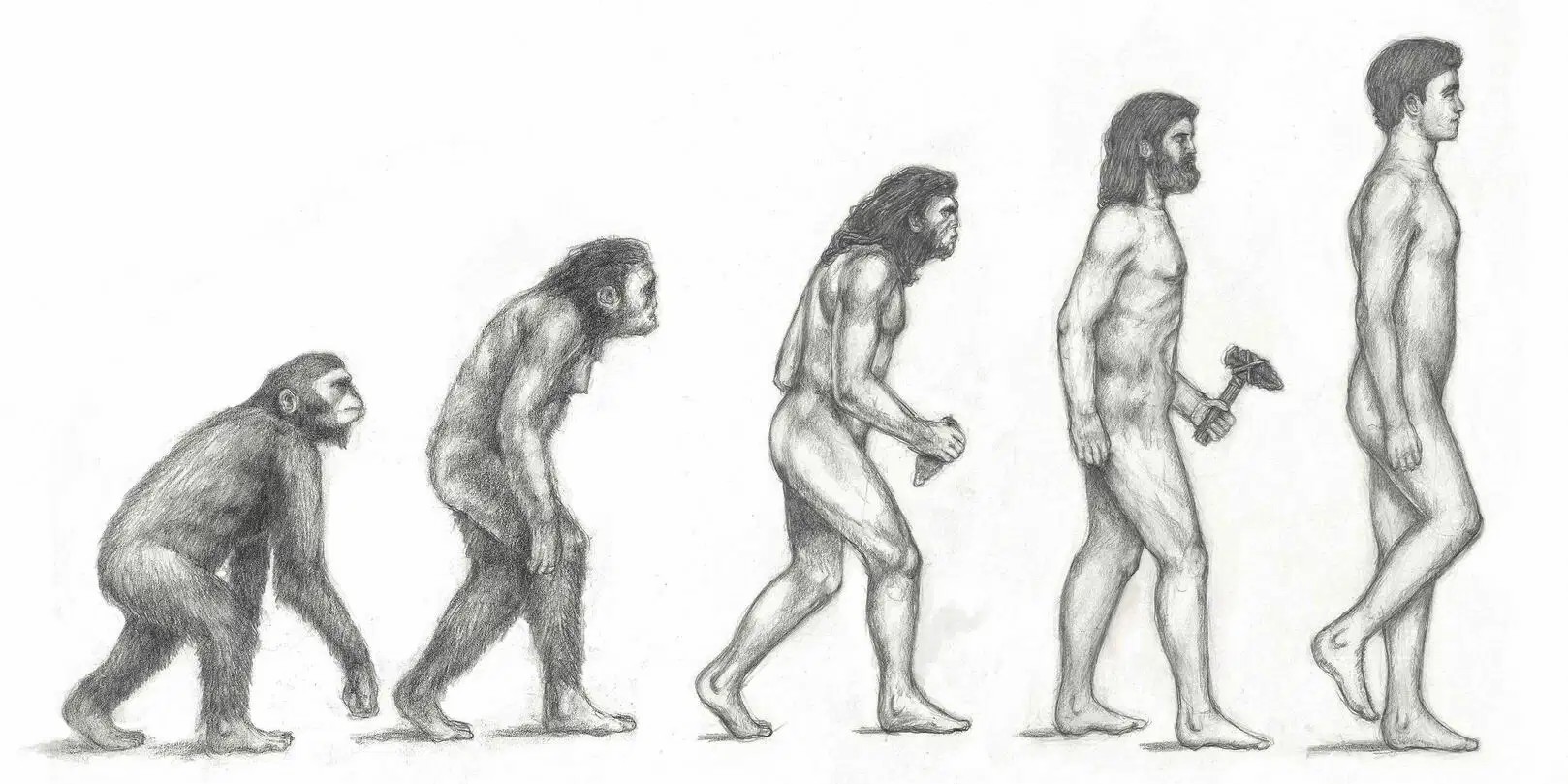
Dans une étude d'ampleur inédite, des chercheurs ont réalisé une vaste synthèse des rapports de domination entre femelles et mâles chez les primates. Une leçon pour les humains ?
Le vrai piège, quand on scrute la vie des singes, c'est de piocher les exemples qui nous arrangent pour justifier nos comportements d'Homo sapiens. Il suffit d'un poil, d'un cri, d'une bagarre pour que chacun y projette ses obsessions. Les partisans de la virilité brutale n'ont qu'à pointer du doigt les chimpanzés, champions du patriarcat velu, pour justifier la domination masculine comme une fatalité gravée dans nos gènes. Mais à deux forêts de là, les bonobos, nos autres cousins partageant 98 % de notre ADN, vivent en majorité sous le règne de la domination des femelles, alliances, sexe et diplomatie en bandoulière.
Avec une équipe internationale, la chercheuse française du CNRS Élise Huchard s'est lancée dans un marathon bibliographique pour aboutir à une enquête titanesque : cinq ans à fouiller les archives, à décortiquer des milliers d'articles, à extraire patiemment les données sur 253 populations de 121 espèces de primates. Leur objectif ? Mettre des chiffres sur ce qui, jusqu'ici, n'était qu'une impression : qui domine qui, et dans quelles circonstances ? « On voulait sortir du binaire : mâle dominant ou femelle dominante. On voulait voir s'il n'y avait pas, entre les deux, tout un spectre de situations plus nuancées, plus flexibles. » La domination masculine n'est pas la règle chez les primates : la réalité est bien plus subtile, bien plus mouvante, et parfois bien plus féminine qu'on ne l'imagine.
Les mâles dominent totalement dans seulement 20 % des groupes de primates.
Et le verdict tombe : dans à peine moins de 20 % des populations étudiées, les mâles dominent totalement les femelles. Symétriquement, dans à peu près la même proportion, ce sont les femelles qui dominent. Mais le plus frappant, c'est ce vaste « entre-deux » : dans 60 % des populations, la domination est flexible et contextuelle. « On a longtemps cru que chaque espèce avait un système figé, binaire. Mais en réalité, il y a une grande plasticité, même au sein d'une même espèce. Chez les bonobos, par exemple, les femelles gagnent en moyenne 70 % des conflits, mais il existe des groupes où un mâle peut être numéro un. Rien n'est jamais totalement figé. »
Leur méthode est aussi simple qu'implacable : recenser, pour chaque espèce, chaque population, toutes les confrontations entre mâles et femelles, et noter qui l'emporte. Parfois, il s'agit d'une bagarre franche, d'un coup de croc ou d'une poursuite. Mais le plus souvent, la domination s'exprime dans des gestes plus subtils, presque rituels : un individu qui s'écarte sur le passage d'un autre, un regard qui fait baisser les yeux, une place cédée sans un mot. « C'est comme dans le métro, quand on laisse sa place à une femme enceinte ou à une personne âgée. Ce sont des codes, des règles de politesse qui disent beaucoup sur la hiérarchie du groupe », sourit la chercheuse.
Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un sexe prend le dessus sur l'autre ? L'étude ne s'est pas contentée de compter les baffes. Bien sûr, la corpulence joue son rôle. Élise Huchard n'est pas qu'un rat de bibliothèque. Depuis vingt ans, elle observe les babouins chacmas en Namibie. Là-bas, la hiérarchie est limpide : « Un mâle de 35 kg, deux fois plus lourd qu'une femelle, impose toujours sa loi. » Quand les mâles sont bien plus costauds, la domination masculine va de pair. Mais ailleurs, le scénario se brouille. Chez les lémuriens de Madagascar, mâles et femelles sont à peu près de même taille, armés de canines équivalentes. Résultat : les femelles dominent, parfois sans partage.
La taille compte, mais ne fait pas tout.
« On s'aperçoit même que lorsque les espèces sont monomorphes, c'est-à-dire avec les mêmes corpulences chez les deux sexes, les femelles dominent plus souvent. » Et plus intéressant encore, pour nous les humains, quand les mâles sont modérément plus lourds que les femelles (comme chez nous), les femelles peuvent dominer. C'est le cas des bonobos. « Le ratio de poids où se fait la bascule vers une dominance stricte des mâles est autour de 1.5, selon nos données. Si un mâle est 25 % plus lourd qu'une femelle, ça ne ferme pas la porte à la dominance des femelles. C'est important parce que le dimorphisme sexuel de taille des humains est justement inférieur à ce point de bascule. »
Mais pour dominer, pas besoin de se battre. Dans de nombreuses sociétés de primates, les femelles établissent leur domination non par la force, mais en contrôlant la reproduction : « Quand les femelles décident avec qui et quand elles s'accouplent, elles tiennent un levier de pouvoir redoutable. Si un mâle se montre trop agressif, la femelle peut lui refuser l'accès au sexe. Les mâles deviennent alors beaucoup plus coopératifs, presque diplomates », raconte Élise Huchard.
Une autre hypothèse expliquerait la présence ou non d'une domination : c'est la compétition entre femelles. Quand la compétition femelle/femelle est aussi féroce que mâle/mâle, la nature favorise des femelles aussi grandes, armées et combatives que leurs homologues masculins, capables de s'imposer sans difficulté. C'est le cas chez les lémuriens, où les femelles dominent souvent les mâles. Cette rivalité se traduit aussi par une intolérance à la proximité d'autres femelles : dans ces espèces, les femelles vivent seules ou en couple, farouchement territoriales, refusant de partager leur espace ou leurs ressources avec d'autres femelles.
Et l'humain dans tout ça ? Élise Huchard reste prudente : « L'étude n'inclut pas les humains. Ce n'était pas sa première vocation de nous renseigner sur nous-mêmes. » Mais difficile d'y échapper. « On a dressé le portrait-robot des espèces à domination féminine, celui des espèces à domination masculine. » Or, l'humain ne coche ni toutes les cases des sociétés à femelles dominantes, ni celles des sociétés à mâles dominants. « Si les humains étaient un primate comme les autres, on serait probablement dans la majorité d'espèces où les relations ne sont pas strictement biaisées, où les rapports de force sont flexibles et mouvants. » Après tout, nos deux plus proches cousins, chimpanzés et bonobos, incarnent chacun un modèle opposé : domination masculine d'un côté, et plutôt féminine de l'autre. « La trajectoire humaine aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, ou rester dans cette zone grise flexible qui varie selon les groupes d'individus. »